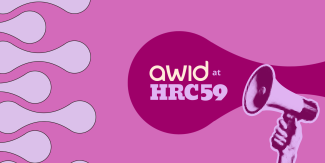Le Conseil des droits de l’homme (CDH) est le principal organe « politique » des droits humains de l’ONU. C'est là que les pays discutent et négocient les questions relatives aux droits humains, se remettent en question et se responsabilisent mutuellement en cas de violations.
(Pour en savoir plus sur le Conseil des droits de l'homme, sa structure et les raisons pour lesquelles les féministes s'y impliquent, cliquez ici!)
Communément considérée comme LA session de l’année abordant les enjeux d’égalité de genre, la 59e session du CDH s’est déroulée sur quatre semaines, entre le 16 juin et le 9 juillet. Elle a proposé des résolutions sur l'autonomisation économique des femmes et leurs droits économiques et sociaux, des tables rondes sur les violences fondées sur le genre dans les situations de conflit, d'après conflit et de crise humanitaire, ainsi que des dialogues interactifs avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales sur le travail de soins et les droits des travailleurs·euses domestiques.
Alors que ces événements avaient lieu, il était impossible d’ignorer, à l'instar des années précédentes, la crise de crédibilité et de légitimité de plus en plus profonde qui se tramait au sein de l'ONU. Entre le recul des normes en matière de droits humains, l'inaction et la complicité des États puissants face au génocide de Gaza, et la crise financière qui touche l'ONU, une question existentielle se pose avec toujours plus d'acuité : les institutions internationales de défense des droits humains peuvent-elles encore jouer un rôle utile dans la recherche de justice et de responsabilité ?
L'égalité de genre à la 59e session du CDH : le danger des approches protectionnistes en matière de droits
La 59e session du CDH a vu les États, les organisations anti-genre et les acteurs institutionnels poursuivre leurs initiatives visant à donner une interprétation restrictive et protectionniste des droits liés au genre et à la sexualité. Si la société civile a salué le texte final de la résolution présentée par le Canada sur l’Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violences à l'égard des femmes et des filles : la prévention par la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, celui-ci a toutefois fait l'objet de neuf amendements, dont six ont été déposés par la Russie et les trois autres par Bahreïn. Ces amendements hostiles, une tactique récurrente utilisée par les États, ont été accompagnés d'arguments prévisibles s'opposant à toute mention de l'éducation sexuelle complète et de l'autonomie corporelle, refusant de reconnaître que ces concepts sont largement acceptés au sein des Nations Unies, malgré leur adoption préalable par le Conseil.
Au cours de cette session, nous avons également constaté un recours accru à la notion de « droits fondés sur le sexe » par les États, un concept défendu ces dernières années par l'actuelle Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles (SR VAW), ainsi que par des organisations chrétiennes conservatrices telle que l'Alliance Defending Freedom. Cette approche de « droits fondés sur le sexe » est en contradiction avec les normes éprouvées en matière de droits humains qui traitent de la discrimination fondée sur le genre. Les organisations féministes ont travaillé d'arrache-pied pour contester cette conception restrictive, biologique et essentialiste de la féminité, en montrant qu'elle trouve ses racines dans une histoire profondément raciste et coloniale qui contrôle et sanctionne les « transgressions » de genre et de sexualité.
Dans son livre Enemy Feminisms, Sophie Lewis rappelle comment les mouvements suffragistes occidentaux se sont volontiers alignés sur les objectifs impérialistes de l'État et les acteurs conservateurs au nom de la « protection des femmes » (principalement blanches et issues de la classe moyenne) contre les hommes racialisés et la « déviance sexuelle ». On peut établir un parallèle évident avec les acteurs conservateurs et les organisations « critiques envers le genre » d'aujourd'hui, qui suivent la même logique paternaliste en matière de genre et de sexualité, selon laquelle les femmes et les filles sont considérées comme intrinsèquement vulnérables et tributaires de la protection de l'État et du patriarcat. Il s'agit ici de les « protéger » soit des femmes transgenres (en imposant des espaces non mixtes), soit du « lobby des proxénètes » (en pénalisant le travail du sexe), soit d'elles-mêmes (en leur refusant une éducation sexuelle complète).
Le rapport de la SR VAW sur les « droits fondés sur le sexe » a été utilisé par des États tels que le Vatican, l'Argentine, le Qatar et l'Égypte pour contester le langage employé sur la violence de genre lors des négociations sur la résolution. Cette dichotomie fallacieuse entre « violence fondée sur le sexe » et « violence fondée sur le genre » occupait une place importante dans la résolution sur l'autonomisation des femmes et des filles à travers le sport, présentée par le Qatar. Bien que l'approche « fondée sur le sexe » n'ait pas été retenue dans le texte final, son contenu était nettement moins ambitieux que celui d'initiatives précédentes, telles que la résolution du CDH sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et des filles dans le sport présentée par l'Afrique du Sud, et le rapport ultérieur du HCDH sur la Convergence de la discrimination raciale et de la discrimination fondée sur le genre dans le sport, demandé par cette même résolution. Saluées par les féministes pour leur analyse structurelle et intersectionnelle de la discrimination raciale et genrée dans le sport de haut niveau, ces initiatives ont constitué une réponse bienvenue à la discrimination dont étaient victimes à l'époque les athlètes noirs, à l'image de Caster Semenya.
Un système de protection des droits humains digne de ce nom devrait nous doter d'outils et de cadres juridiques permettant de responsabiliser les États et les acteurs non étatiques en cas de violation des droits humains, plutôt que de nuire davantage aux personnes transgenres, aux travailleurs·euses du sexe et aux communautés racialisées. La résurgence du débat « genre vs sexe » dans le système des droits humains est une illustration du flicage du genre qui se produit à l'échelle mondiale, comme en témoignent le cas d'Imane Khelif, la boxeuse algérienne qui a été prise pour cible aux Jeux olympiques en raison des questions soulevées sur son genre, ou la série de mesures législatives visant à restreindre l'autonomie corporelle des personnes transgenres au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Le système des droits humains et son absence de réaction face aux génocides actuels et à l’iniquité de l’ordre économique
En réalité, le manque de crédibilité du système des droits humains a toujours été lié à son incapacité (et refus) de s'attaquer de manière significative aux formes héritées et contemporaines de l'impérialisme, du colonialisme et du racisme, ainsi qu'à son cousin (plus récent), le néolibéralisme. L'exemple actuel le plus flagrant est l'attitude des États occidentaux et des acteurs institutionnels qui soutiennent des politiques « progressistes » visant à défendre l'autonomie corporelle et les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, mais refusent catégoriquement de reconnaître l'autodétermination et l'autonomie corporelle du peuple palestinien. Leur complicité ne s'arrête pas à l'apartheid et au génocide perpétrés en Palestine; elle s’étend aussi aux préjudices causés par le pouvoir des entreprises, l'extractivisme et le commerce des armes.
Les sanctions prises par les Etats-Unis(et le silence subséquent des États occidentaux) à l'encontre de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens, Francesca Albanese, en réponse à son rapport dénonçant la complicité des entreprises dans le génocide en Palestine.
De même, les féministes ont soulevé le fait que les systèmes de gouvernance mondiale sont répartis entre, d’un côté, des institutions dotées d'un « pouvoir réel », comme les traités commerciaux et les systèmes économiques coercitifs, et de l’autre, d'autres institutions, comme le système des droits humains, manifestement conçus pour se donner bonne conscience. L'architecture financière mondiale elle-même n'est qu'un instrument du néolibéralisme et de la colonisation qui exerce un contrôle sur les pays du Sud via le fardeau de la dette, les mesures d'austérité, les programmes d'ajustement structurel et les conditions de prêt. Malgré les efforts consentis par la société civile pour inciter les organismes de défense des droits humains (et directement des institutions telles que l’Organisation mondiale du commerce) à demander des comptes à ces systèmes économiques, ces processus sont souvent pris en otage par certains États puissants qui ont tout intérêt à maintenir le statu quo.
La société civile et les Nations Unies face à la restriction budgétaire, la militarisation et la capture corporative
À l'heure actuelle, l'argent est investi dans les dépenses militaires et remplit les poches des entreprises et de l'élite mondiale. Les organisations de la société civile, en particulier celles de la majorité mondiale, sont les plus touchées par cette crise financière. Alors que les donateurs redéfinissent leurs priorités ou réduisent considérablement leur financement, de nombreuses organisations ferment leurs portes ou procèdent à des réductions drastiques de leur activité. Cette situation est d'autant plus grave que les États puissants se détournent de la coopération multilatérale et de leur contribution financière au système multilatéral, ce qui entraîne une réduction des financements au sein du système des Nations Unies. Cette situation a eu des conséquences graves que l'on a pu clairement constater au cours de la présente session, qu'il s'agisse de la réduction du nombre de séances et de rapports, de l'espace limité accordé aux manifestations organisées en marge par la société civile ou encore de l'absence de participation hybride. Les moyens dont disposait la société civile pour responsabiliser les États et lutter contre les injustices inhérentes au système se réduisent comme peau de chagrin.
Au fond, l'impact tant des initiatives ouvertement « anti-genre » que celui du «purplewashing » camouflé sont autant de tests qui mettent à l'épreuve la ligne politique des défenseurs·euses du féminisme au sein du CDH. Alors lorsque le genre et la sexualité sont utilisés comme des pions et cooptés par le système et les États pour faire bonne figure ou, pire encore, pour dissimuler leurs abus, voire les deux, qu'est-ce que cela signifie pour les féministes ? Même si les féministes qui ont accès à ces espaces sont conscient·e·s du manque de crédibilité dont souffre le système des droits humains, elles·ils peuvent estimer qu’il leur coûterait trop cher d'y renoncer, surtout lorsque les activistes nationales·aux y voient l'un des rares moyens visibles de responsabilisation. De plus, que dirait de nous le fait d’ignorer cette question alors que les communautés les plus touchées par les violations en tous genres, en particulier le génocide, continuent de réclamer la responsabilisation du système et de ses acteurs ?
En période de crise, nous devons opter en faveur d'une politique solidaire et nous attaquer aux questions fondamentales qui se posent sur notre rapport au pouvoir, aux ressources et aux institutions. De l'inégalité de l'ordre politique et économique mondial à la récupération néolibérale de nos droits, le contexte politique actuel nous invite à repenser notre approche étroite et cloisonnée des questions de genre et de sexualité, à résister aux discours réactionnaires et à nous opposer à la cooptation de nos luttes au profit d'intérêts à court et moyen terme. il n'existe pas de recette miracle en la matière. Si un an s'est écoulé depuis la 68e session de la Commission de la condition de la femme, la question centrale soulevée par Sachini Perera dans cet article de réflexion reste plus pertinente que jamais :
« Que serions-nous prêt·e·s à perdre — temporairement et/ou définitivement — si nous adoptions des positions audacieuses, sans concession, contestataires et internationalistes, que ce soit au sujet de la Palestine, du Soudan, de l'Iran, du Congo, du Cachemire, de la Papouasie occidentale ou du Sahara occidental ? Ou si nous faisions comprendre aux champions de l'égalité de genre, parmi les États membres, que leur alliance, leur soutien et leur « purple/pinkwashing » ne peuvent plus servir à négocier et choisir lesquelles de nos luttes ils vont défendre ? »
1Sophie Lewis Enemy Feminism: TERFs, Policewomen, and Girlbosses Against Liberation (2025) pg.109